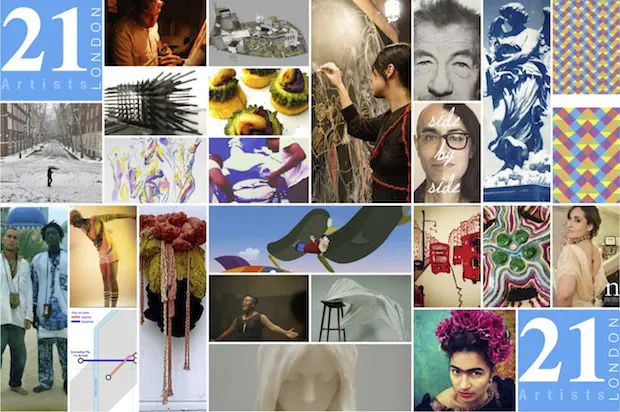J’étais sorti un soir avec une amie, une étudiante étrangère en échange universitaire, et j’essayais d’arrêter un taxi pour rejoindre son appartement. Positionnée dans une rue venant d’Union Square Park, au coeur de San Francisco, elle commença à faire signe à plusieurs taxis, mais seulement pour les voir passer avec des passagers à bord. En vrai gentleman, j’essayais également mais fus ignoré par une autre demi-douzaine de taxis avant qu’enfin l’un d’eux s’arrête.
«Cela doit être sympa d’être blanc» lança-t-elle, pince-sans-rire, alors que nous nous enfoncions dans les sièges arrières après ces 20 minutes d’épreuve.
Que sa façon de procéder soit acceptable ou non, c’est la plus courante pour appeler un taxi. Mais une dure vérité s’impose : appeler des taxis à San Francisco est difficile et chronophage. Alors qu’un visiteur, peut-être peu familier avec les autres moyens de circuler en ville, il pourrait imputer cela à un échec du marché à satisfaire la demande. Toute personne bien informée des politiques locales sait qu’il en est autrement.
Depuis des décennies, l’industrie des taxis à San Francisco a été fortement régulée. Mais à la différence des autres industries dans lesquelles les réglements n’ont conduit qu’à ajouter des frais généraux, celles des taxis ont été plus flagrantes. Il existe, en effet, une limite de leur nombre autorisé en ville, limite imposée par l’Agence Municipale des Transports (MTA). Elle a été établie en 1978 lorsqu’une ancienne agence a attribué 1500 médaillons de taxi. Ces médaillons permettent à leur propriétaire de louer leurs voitures lorsqu’ils ne les utilisent pas, une politique qui a conduit à produire aujourd’hui 5000 conducteurs.
Mais ce nombre, comme l’industrie le reconnaît, est aujourd’hui trop faible. Actuellement, il existe une liste d’attente de 1500 conducteurs qui souhaiteraient des médaillons, mais ne peuvent en obtenir avant que quelqu’un parte en retraite. Nombreux sont ceux qui sont sur cette liste depuis 15 ans, ayant été durant ce temps employés des détenteurs actuels de médaillons. Mais ils s’obstinent, malgré les frais annuels que leur demande la MTA, pour la manne financière que représenterait l’éventuelle obtention d’un médaillon.
La MTA reconnait également cette manne. En 2010, cela s’est traduit par l’expérimentation de transferts de médaillons qui aurait couté à chaque nouveau détenteur 250 000 dollars, l’agence, elle-même en obtenant une part. Les conducteurs visés dans la liste d’attente, indiquèrent que les médaillons avaient été jusque là gratuits, et que cette dépense nouvelle et arbitraire comprometait leurs chances en tant que propriétaires. Mais la MTA resta inflexible et en août dernier, elle augmenta le coût à 3 00 000 dollars et leur part à 50%. Il est prévu que cette mesure génère 22 millions de dollars pour l’agence, aux dépends bien sûr des futurs propriétaires de taxi et de leurs clients.
La question, une fois associée au sous-approvisionnement de médaillons et à leur valeur, est de savoir pourquoi la MTA n’en produit-elle pas simplement plus ? Même les 200 qui ont été ajoutés récemment ne seront que provisoires. La raison est qu’elle ne souhaite pas exposer les propriétaires actuels de médaillons à une montée de la compétition, un point qui n’attire que peu de sympathie pour disons n’importe quel héleur de taxi qui s’est déjà retrouvé seul dans une attente interminable tard le soir, dans cette soufflerie morale et physique qu’est Market Street.
Malheureusement, les régulations des taxis de San Francisco ne viennent pas seulement de la Ville ou des affaires avec les véhicules actuels. En novembre dernier, la California Public Utilities Commission a dressé des contraventions à trois start-up de la Ville, Uber, SideCar et Lyft, pour leurs effets indirects sur le marché. Ces compagnies avaient créé des applications par téléphone qui mettaient en liens les demandeurs de taxi avec les conducteurs à proximité, indiquant les temps d’attente et débitant les cartes de crédit. La commission, semblant incapable de faire des distinctions, a accusé les compagnies de gérer des services de limousine sans licence. Sunil Paul, le PDG de SlideCar, l’une des sociétés poursuivies, a expliqué que sa compagnie n’était rien d’autre qu’un intermédiaire à la sauce digitale. Refusant l’appellation service de limousine, il revendique que ce serait «comme dire que Airbnb est une chaine d’hotels» ou Travelocity une compagnie d’aviation.
La commission a défendu la contravention en affirmant que ces start-up n’avaient pu démontrer que les chauffeurs dont ils faisaient la publicité avaient leur licence. Mais ces chauffeurs avaient déjà subi des tests de licence de la part de leur employeur rendant cette obligation redondante. L’explication la plus probable pour ces restrictions ici et dans d’autres villes, est que ces compagnies affrontent la résistance des municipalités et des syndicats cherchant à protéger leur monopole des taxis car elles font la publicité de services alternatifs comme des limousines ou des véhicules de livraison.
A San Francisco, ce désordre confus de licences, régulations et contraventions sont conçues davatage pour protéger les chauffeurs mentionnés ci-dessus, qui, d’après Robert McNamara de l’Institut de Justice, «pensent que ce serait formidable que personne ne leur fasse concurrence». Mais ils n’aident certainement pas les chauffeurs aspirants qui se trouvent coincés dans une industrie généralement connue pour son entreprenariat ascendant. Ils n’aident pas non plus les consommateurs qui sont touchés par des prix très élevés et des services dépassés et qui doivent pratiquement sauter bras et jambes écartés au milieu des rues s’ils veulent être emmenés quelque part.